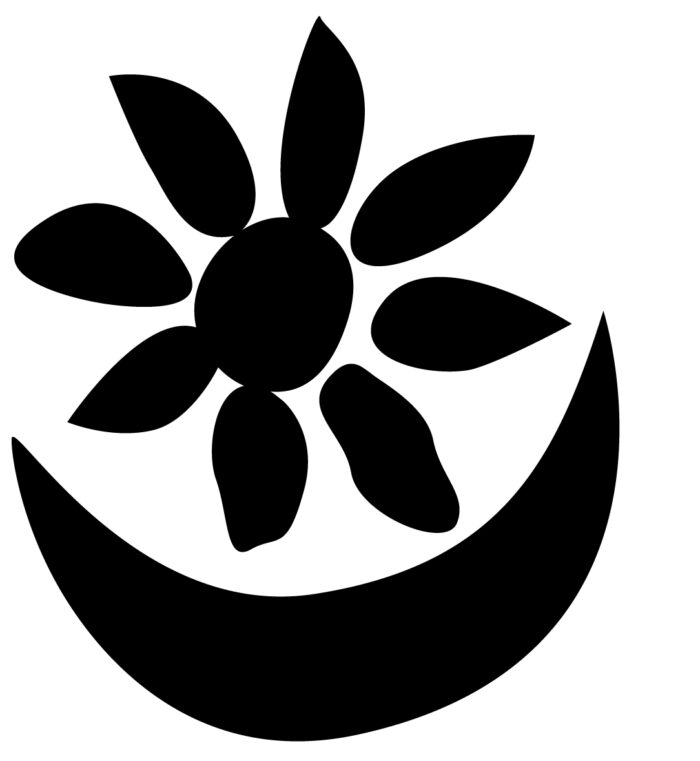Dans son ouvrage The Grand Chessboard publié en 1997, Zbigniew Brzeziński, le conseiller à la sécurité nationale du président Jimmy Carter, avançait que le contrôle de l’Eurasie était crucial pour maintenir la suprématie américaine, et présentait une série de réflexions stratégiques œuvrant à cet objectif. L’Iran, identifié comme puissance moyenne, mais pièce angulaire régionale en raison de ses ressources et de sa position stratégique, devait être figé au moyen d’un dispositif mixte altérant son influence continentale, composé de sanctions économiques, de la construction d’un foyer régional de rivaux, et du soutien d’activistes au sein du pays, pour favoriser en temps voulu un changement de régime. La promotion d’une diplomatie continue servant de fil directeur à ces mesure techniques, complétait cet appareil préventif, aussi l’option d’une confrontation militaire directe devant être évitée, sous peine d’embrasement.
Une attaque aux conséquences incontrôlables
Or, l’attaque brutale de l’Iran par Israël survenue le vendredi 13 juin dernier, planifiée, au regard du dispositif composite employé et de son action en profondeur, matérialise l’élément déclencheur que Brzeziński souhaitait éviter. Constituant une violation incontestable de l’article 2 paragraphes 3 et 4 de la charte des Nations-Unies, cette offensive s’est de surcroit déroulée deux jours avant les négociations sur le nucléaire, initialement prévues sous le patronage du sultanat d’Oman, desquelles l’Iran a souhaité se retirer au regard de l’agression subie sur son territoire. De celle-ci émergea une riposte iranienne, permise par le droit naturel de légitime défense[1], conduisant inévitablement au principe d’escalade tant redouté.
Que faut-il craindre aujourd’hui ? Une radicalisation des positions bilatérales, qui pourraient installer le conflit dans la durée, et augmenter le nombre des victimes civiles iraniennes et israéliennes, populations unies de fait dans l’adversité malgré les 2.308 km qui séparent leurs capitales. L’intervention américaine également, – sans imaginer, qu’à l’instar des deux guerres du Golfe, l’envoi de centaines de milliers de soldats au sol soit aujourd’hui possible – qui pourrait prendre la forme d’un bombardement stratégique à haute altitude conformément aux préceptes du général Giulio Douhet (1869-1930), qui avançait que ce mode opératoire n’est pas tributaire de la géographie, et permet de remporter la victoire en détruisant toute infrastructure vitale. Or cette option militaire, nonobstant son immoralité, constituerait une erreur sur le long terme du point de vue d’une tentative de division, car les populations bombardées tendent à faire corps, et à oublier les discordes internes devant un ennemi commun. Ceci est particulièrement vrai pour les Iraniens, dotés d’une conscience aigüe de l’importance historique de leur pays, qui fit dire à Ardavan Amir-Aslani qu’ils « […] habitent dans le temps, et non dans un espace donné »[2].
Les intérêts américains et le précédent irakien
Plus qu’au bellicisme de Benyamin Netanyahou, le monde est aujourd’hui suspendu à la décision de Donald Trump d’intervenir ou non en Iran, et la question est de savoir si l’offensive israélienne, constitue pour les américains une opportunité qu’il convient de saisir pour défaire l’alliance « anti hégémonique » entre la Chine la Russie et l’Iran, qui nuit objectivement à la prolongation de l’imperium américain en Eurasie. Cette option serait contraire aux promesses de campagnes du 47e président des Etats-Unis, construites autour de la dénonciation d’opérations militaires couteuses conduites par ses prédécesseurs ; sa doctrine prône cependant « […] une utilisation massive et unilatérale de [l’outil de défense américain] pour la destruction rapide de toute menace directe à l’encontre des intérêts fondamentaux de la nation».[3] À ce stade, seul le prétexte d’un programme iranien d’enrichissement d’uranium de qualité militaire, pourrait justifier cette intervention, mais il se heurte au passif de l’invasion américaine de 2003 en Irak, motivée à l’époque par un narratif mensonger sur la possession par le régime de Saddam Hussein, de stocks d’armes prohibées. Le rapport rédigé par Charles Duelfer, le chef des inspecteurs en désarmement américain pour l’Irak, rendu public en octobre 2004, confirmait l’absence de toute menace imminente d’ordre chimique ou bactériologique[4].
Devant le dilemme d’une guerre d’attrition couteuse pour chaque partie, ou de haute intensité par intervention de tiers, l’option diplomatique reste la seule voix envisageable pour préserver l’équilibre régional, mais il ne peut être garanti que par la participation active des 10 pays du Sud global, afin de lever toute ambiguïté concernant la tentation du bloc occidental de poursuivre un objectif de refonte « du Grand Moyen-Orient », issu d’un certain atavisme néoconservateur.
[1] FORTEAU Mathias. Jean-Pierre COT et Alain PELLET (dir.), La Charte des Nations-Unies, Commentaire article par article, « Article 51 », tome 1, 3e éd. Paris, Economica, 2005, pp. 1329-1360.
[2] ARDAVAN Amir-Aslani, L’Iran, cœur battant de la civilisation musulmane, Diplomatie n°91, septembre, octobre 2018, pp. 87-91.
[3] LE CHAFFOTEC Boris, « Paix armée et approche transactionnelle : quelle politique de défense américaine sous Donald Trump ? », Les Champs de Mars, n°30, 2018, pp. 147-156.
[4] « Selon un nouveau rapport, l’Irak ne présentait pas une menace en 2003 », Le Monde, 6 octobre 2004.